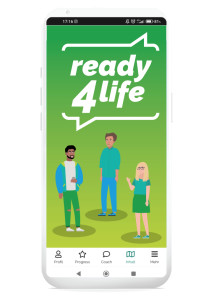Pour mieux illustrer l’importance de ces médias dans la diffusion d’information, prenons l’exemple de la campagne contre le Covid-19. Durant la pandémie de Covid-19, d'avril 2020 à fin 2022, environ une trentaine de médias ont systématiquement diffusé les informations et les messages du Conseil fédéral auprès de leurs communautés linguistiques en 17 langues. En s’appuyant sur différents supports tels que des vidéos, des entretiens en ligne, des newsletters, des bannières, et des posts sur les réseaux sociaux, un total de 900 contributions a été réalisées.
Cette démarche permet non seulement aux personnes migrantes défavorisées – personnes âgées ou ayant un faible niveau de formation formelle, par exemple – d’accéder aux informations adaptées à leurs besoins, mais renforce également l’acceptabilité des informations reçues. Car elles sont diffusées via des canaux qui leur sont proches.
Les principaux défis sont la numérisation des services, des informations et la fracture numérique qui l’accompagne. Bien que de nombreuses informations de santé, comme les dossiers électroniques, soient disponibles en ligne, ces populations peuvent ne pas avoir accès aux technologies nécessaires pour les consulter. Ce problème est aggravé par un manque de compétences en santé numérique qui rend difficile l'utilisation efficace des outils disponibles.
Dans le domaine de l'addiction, ce problème est particulièrement aigu. Les informations sur les services de soutien et les offres de prévention sont souvent en ligne, mais l'accès limité aux technologies et la faible littératie numérique empêchent les personnes défavorisées d'utiliser des applications et plateformes en ligne, comme l'application « Stop-tabac » pour en citer qu’un exemple, destinée à aider les personnes à arrêter de fumer. Néanmoins, la fracture numérique qui touchent davantage les personnes défavorisées constitue une barrière supplémentaire parmi d’autres empêchant la plupart de cette population de profiter suffisamment de cette offre qui doit être accueille à toutes les personnes.
En investissant davantage dans le développement des compétences en santé numérique chez les personnes défavorisées, nous pouvons améliorer l'accès à l'information et aux offres de prévention numériques.